Introduction
Cet épisode intitulé « Le moment œdipien » s'inscrit dans la série consacrée à une contre-histoire de la philosophie. Il propose une analyse critique du complexe d'Œdipe tel que formulé par Freud, en le replaçant dans une généalogie philosophique et culturelle beaucoup plus vaste. L’épisode interroge les fondements mythologiques, philosophiques et psychanalytiques du mythe d’Œdipe pour en dégager les implications idéologiques et anthropologiques.
1. Le mythe d’Œdipe : un récit fondateur problématique
Le mythe d’Œdipe, tel qu’on le trouve chez Sophocle, présente un homme condamné par une prophétie à tuer son père et épouser sa mère. Ce récit, repris par Freud, est considéré comme fondateur dans la compréhension de la psyché humaine.
• Œdipe est victime d’un destin tragique imposé par les dieux, ce qui soulève des questions sur la responsabilité individuelle.
• Il ignore l’identité de ses parents, ce qui rend ses actes involontaires.
• La punition finale (aveuglement, exil) renforce la dimension sacrificielle du personnage.
Or, cette lecture mythologique masque selon Michel Onfray une volonté plus profonde de transmettre une morale sacrificielle, culpabilisatrice et religieuse.
2. La récupération freudienne : invention du complexe d’Œdipe
Sigmund Freud fait du mythe d’Œdipe un modèle universel du développement psychique de l’enfant mâle : désir de la mère, rivalité avec le père.
• Cette théorisation freudienne repose sur une lecture littérale et patriarcale du mythe.
• Freud construit une anthropologie fondée sur la répression du désir sexuel, introduisant le surmoi comme gardien moral intérieur.
• Il projette son propre rapport personnel et familial sur une théorie généralisée de la sexualité humaine.
Cette universalisation du cas personnel (Freud, fils aimé d’une mère et rival du père) transforme le mythe en dogme pseudo-scientifique.
3. Œdipe comme figure christique
Le destin tragique d’Œdipe se rapproche de la figure du Christ dans sa structure narrative : souffrance, sacrifice, rédemption par la douleur.
• L’aveuglement d’Œdipe évoque une forme de crucifixion païenne.
• Son exil devient une errance rédemptrice.
• Comme Jésus, il porte sur lui la faute du monde (inceste, parricide).
Cette analogie met en évidence la christianisation du récit grec, comme si la culture occidentale avait eu besoin d’un proto-Christ avant l’ère chrétienne.
4. Une morale sacrificielle issue du judéo-christianisme
Michel Onfray analyse la psychanalyse comme héritière d’une tradition religieuse culpabilisatrice, où le mal et la faute sont intériorisés.
• Freud remplace Dieu par l’inconscient, le péché par le désir.
• Le surmoi devient une nouvelle version de la voix divine, jugeant sans appel.
• La cure psychanalytique s’apparente à une confession laïque où l’analysant avoue ses fautes.
La psychanalyse reconduit donc une logique de péché originel et de rédemption dans une version sécularisée du christianisme.
5. Le refus des modèles alternatifs au complexe d’Œdipe
Des penseurs comme Nietzsche ou Reich proposent d’autres lectures du désir et de la pulsion.
• Nietzsche valorise la force dionysiaque, la libération des instincts, contre la culpabilité.
• Wilhelm Reich voit dans la répression sexuelle un outil de contrôle social et prône une énergie libidinale libre et non coupable.
• Ces alternatives sont systématiquement marginalisées ou disqualifiées par l’institution psychanalytique freudienne.
Cela montre le caractère dogmatique et idéologique de la psychanalyse classique.
6. Une critique politique du complexe d’Œdipe
Le complexe d’Œdipe, loin d’être neutre, participe d’un ordre social et politique conservateur.
• Il valorise la famille nucléaire patriarcale.
• Il entérine l’autorité du père comme figure de loi.
• Il culpabilise les désirs non conformes (homosexualité, désir anarchique).
En naturalisant un modèle familial bourgeois, la psychanalyse contribue à la reproduction des rapports de domination.
7. Œdipe contre les matérialistes
Œdipe incarne un renversement du matérialisme antique, notamment des penseurs comme Démocrite et Épicure.
• Chez ces penseurs, le monde est régi par la nature et non par la faute.
• Le plaisir est une composante naturelle de la vie humaine, non coupable.
• Le mal n’est pas inhérent à l’homme, mais résulte de constructions sociales.
La réintroduction de la faute et du péché via Œdipe va donc à l’encontre de la sagesse antique matérialiste.
💡 Conclusion
Le moment œdipien, tel que pensé par Freud, est une réinterprétation moderne d’un mythe ancien, chargé d’implications religieuses, morales et politiques. Ce modèle, érigé en vérité universelle, repose sur une vision culpabilisatrice du désir humain, héritée du judéo-christianisme. En déconstruisant cette figure, Michel Onfray invite à repenser l’anthropologie occidentale à partir d’autres sources philosophiques : matérialisme antique, affirmation de la vie, pluralité des modèles culturels. L’Œdipe freudien apparaît alors comme une fiction idéologique au service d’un ordre social donné.
📚 Philosophes et concepts mentionnés
Œdipe — Héros tragique grec, symbole du destin et de la faute involontaire.
Sophocle (env. 496 av. J.-C. – 406 av. J.-C.) — Tragédien grec, auteur d’« Œdipe roi ».
Épicure (341 av. J.-C. – 270 av. J.-C.) — Philosophe matérialiste, partisan du plaisir comme but de la vie.
Démocrite (env. 460 av. J.-C. – env. 370 av. J.-C.) — Philosophe grec, fondateur de l’atomisme.
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) — Philosophe allemand, critique de la morale chrétienne.
Sigmund Freud (1856 – 1939) — Médecin autrichien, fondateur de la psychanalyse.
Wilhelm Reich (1897 – 1957) — Psychanalyste et marxiste, théoricien de la libération sexuelle.
Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie







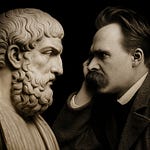

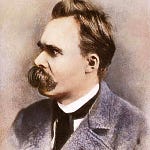




Share this post