1. Introduction
Michel Onfray conclut son cycle sur Jean-Marie Guyau en révélant la face sombre de sa pensée. Bien que rattaché aux Lumières et à une morale sans obligation ni sanction, Guyau développe dans ses écrits une idéologie hygiéniste et nationaliste aux accents protofascistes. Cet épisode explore comment une pensée républicaine peut dériver vers une logique autoritaire.
2. Le surhumain et l’épicurisme
Guyau emploie le mot « surhumain » pour désigner un idéal d’humanité accomplie, à la fois robuste, féconde et en accord avec les lois du cosmos. Héritier d’Épicure et de Spinoza, il conçoit une spiritualité immanente où le divin réside dans la vie elle-même. L’individu est appelé à vivre pleinement pour participer à l’élan de l’univers.
3. Une morale pour bâtir un homme nouveau
La morale de Guyau vise à produire un homme à venir, au-delà de l’humain actuel. Il imagine un type supérieur dont l’évolution est à la fois biologique et morale. Ce projet éducatif s’ancre dans une logique de transformation de l’espèce humaine, annonçant des idées eugénistes.
4. La République contaminée
Guyau incarne l’idéologie morale de la Troisième République. Mais Onfray montre comment cette pensée républicaine, en apparence progressiste, partage de nombreux points avec l’idéologie de Vichy : racisme, natalisme, xénophobie, culte du sacrifice, rejet du métissage, et opposition à la modernité urbaine.
5. Racisme et hiérarchie des races
Guyau affirme la supériorité de la race blanche française, au-dessus des Noirs, Arabes, Turcs, Chinois… Il soutient que ces derniers ont une conscience moindre et souffrent donc moins. Le remords, par exemple, ne concernerait que les sujets les plus évolués. Onfray insiste sur le fait que cette pensée, bien que pré-Auschwitz, en prépare l’idéologie.
6. Antisémitisme et fantasme aryen
Même si l’antisémitisme de Guyau est peu développé, Onfray souligne sa présence, notamment dans l’association entre les juifs et l’avarice. En parallèle, Guyau célèbre les Aryens et attribue aux Grecs la naissance de la science et du grand art. Une grille raciale hiérarchique s’en dégage.
7. Contre l’américanisme et la ploutocratie
Guyau critique le capitalisme américain, qu’il voit comme le règne de l’argent, du lucre, de l’intérêt, opposé à l’idéal intellectuel désintéressé de la République. Il redoute que la domination financière étrangère efface la grandeur de la civilisation française.
8. L’éloge du paysan et le rejet de l’ouvrier
Guyau oppose le paysan robuste, en contact sain avec la nature, à l’ouvrier des villes, fragile, alcoolique, prostitué, malade. Cette dichotomie prépare le discours pétainiste sur la terre nourricière et les valeurs rurales. Le paysan devient le modèle du citoyen idéal, porteur d’hygiène morale et physique.
9. Hygiénisme d’État et formatage des corps
Guyau propose un programme étatique de transformation des individus : éducation, dressage, création d’habitudes, rotation entre ville et campagne (assolement). L’objectif est de produire des corps sains, des esprits disciplinés, prêts au sacrifice national. Une préfiguration des chantiers de jeunesse de Vichy ou des dérives maoïstes.
💡 Conclusion
L’œuvre de Guyau révèle une tension irrésolue : une morale de la vie sans contrainte coexiste avec un projet autoritaire de formatage des individus. L’hygiénisme républicain devient une religion séculière du devoir, du sacrifice, et de la pureté raciale. Onfray montre comment une philosophie née des Lumières peut engendrer une nuit idéologique, prête à féconder les totalitarismes du XXe siècle.
📚 Philosophes mentionnés
Protagoras (env. 490 – env. 420 av. J.-C.) — Sophiste grec, célèbre pour son relativisme : « L’homme est la mesure de toute chose », opposé aux absolus platoniciens.
Démocrite (env. 460 – env. 370 av. J.-C.) — Philosophe grec matérialiste, connu pour sa théorie atomiste du monde.
Épicure (341 – 270 av. J.-C.) — Philosophe grec matérialiste, fondateur de l’épicurisme, prônant la recherche du plaisir comme absence de trouble (ataraxie) et la vie simple.
Lucrèce (env. 98 – env. 55 av. J.-C.) — Poète et philosophe romain, auteur du De rerum natura, exposant la pensée épicurienne.
Spinoza (1632 – 1677) — Philosophe rationaliste néerlandais, défenseur d’une éthique fondée sur la connaissance intuitive de la nature, de l’immanence et du désir comme moteur vital.
La Mettrie (1709 – 1751) — Médecin et philosophe français, auteur de L’Homme machine, défendant une vision mécaniste de l’humain.
Diderot (1713 – 1784) — Philosophe des Lumières, cofondateur de l’Encyclopédie, défenseur du matérialisme et de la liberté de pensée.
d’Holbach (1723 – 1789) — Philosophe matérialiste radical, promoteur de l’athéisme et critique virulent de la religion.
Cabanis (1757 – 1808) — Médecin et philosophe français, célèbre pour ses travaux liant physiologie et pensée, figure du matérialisme médical.
Broussais (1772 – 1838) — Médecin français, défenseur du vitalisme en médecine et promoteur d’une physiologie centrée sur l’irritation.
Feuerbach (1804 – 1872) — Philosophe allemand, influencé par Hegel, critique de la religion qu’il considère comme une projection de l’homme.
Broca (1824 – 1880) — Médecin et anthropologue français, connu pour ses recherches sur le cerveau et le langage, fondateur de l’anthropologie physique.
Nietzsche (1844 – 1900) — Philosophe allemand de la volonté de puissance, de l’éternel retour et du surhomme, critique radical des valeurs morales traditionnelles et du nihilisme.
Sébastien Faure (1858 – 1942) — Militant anarchiste français, promoteur de l’éducation libertaire, figure marquante du mouvement anarchiste individualiste et rationaliste.
Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie








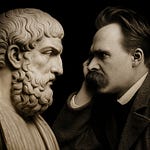


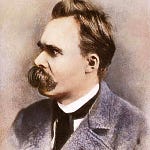


Share this post