Introduction
Cet épisode intitulé « Aimer le vouloir qui nous veut » est consacré à la pensée de Friedrich Nietzsche, plus précisément à sa conception du destin, du temps, de l’instant et de la volonté. À travers une analyse du concept d’« amor fati » — aimer son destin — Nietzsche s’oppose frontalement à l’idéalisme platonicien, à la morale chrétienne et à la nostalgie d’un passé figé. Il propose au contraire une philosophie de l’instant, de l’acceptation de la réalité telle qu’elle est, et de la puissance vitale de la volonté. Ce résumé met en lumière les différents aspects de cette pensée telle qu’exposée dans la série de Michel Onfray.
1. La haine de la vie dans la métaphysique classique
Depuis Platon, une partie importante de la philosophie occidentale se fonde sur un rejet du monde sensible au profit d’un monde idéal, parfait et éternel. Cette posture, reprise par le christianisme, suppose que la vie terrestre est imparfaite, souffrante et inférieure. La vérité et le bien résident alors hors de ce monde. Cette dualité entraîne une dévalorisation de l’ici et maintenant.
Nietzsche voit dans cette métaphysique une haine de la vie : en idéalisant un au-delà ou un monde des idées, on nie la valeur de l’expérience vécue. La philosophie occidentale traditionnelle s’est ainsi construite sur une dépréciation de la réalité sensible et sur une obsession de la stabilité et de l’éternel.
2. Le refus du passé et du présent dans la tradition chrétienne
La théologie chrétienne renforce cette négation du présent en valorisant un paradis perdu (le jardin d’Éden) et un salut futur dans l’au-delà. Le présent devient un lieu de chute, de faute et de douleur, dont il faut s’échapper. Cette vision linéaire du temps (chute – rachat – salut) oppose radicalement le monde de Dieu au monde des hommes.
Nietzsche s’oppose à cette conception en réhabilitant l’instant présent et le caractère tragique de la vie. Il rejette la nostalgie et l’espérance chrétienne au profit d’un consentement au réel. Il ne s’agit pas de fuir le monde mais de l’aimer tel qu’il est.
3. L’instant comme lieu de vérité
Pour Nietzsche, seul l’instant est réel. Le passé n’est plus, le futur n’est pas encore, seul l’instant présent est tangible. Or, cet instant est souvent méprisé ou instrumentalisé par les philosophies religieuses et idéalistes qui le considèrent comme imparfait ou transitoire.
La grandeur de l’instant repose dans son intensité, sa fulgurance, sa capacité à nous révéler à nous-mêmes. C’est dans l’instant que se joue la vérité de l’existence. Il faut donc cesser de fuir l’instant pour l’habiter pleinement.
4. La volonté affirmée contre le ressentiment
Nietzsche valorise une volonté puissante qui affirme la vie, y compris dans ses douleurs et ses épreuves. Cette volonté est l’inverse du ressentiment, sentiment typique des faibles qui refusent le réel, le rejettent ou le critiquent sans agir.
L’homme noble, au sens nietzschéen, est celui qui dit « oui » à l’existence, qui ne cherche ni à la fuir ni à la transcender. Cette affirmation joyeuse et tragique est l’expression d’une puissance vitale.
5. L’éternel retour : une épreuve pour la volonté
Le concept de l’éternel retour pose la question suivante : serais-tu prêt à revivre ta vie, à l’identique, pour l’éternité ? Ce mythe philosophique est un test. Celui qui accepte de revivre la même existence, dans toutes ses joies comme dans ses douleurs, manifeste une force de vie exceptionnelle.
L’éternel retour n’est pas une croyance cosmologique, mais un critère éthique : seule une volonté affirmative, forte et libre, peut dire « oui » à une telle répétition. Aimer ce qui advient, c’est donc aimer son destin — amor fati.
6. Amor fati : consentir au monde tel qu’il est
Aimer son destin, ce n’est pas seulement l’accepter, mais l’aimer activement, sans regret ni nostalgie. C’est le cœur de la sagesse nietzschéenne : ne rien vouloir d’autre que ce qui est, y compris le malheur, l’échec, la douleur.
Cela implique une grande force d’âme et une maturité spirituelle. Là où les autres cherchent des échappatoires, des compensations ou des justifications, l’homme nietzschéen assume pleinement ce qu’il est, ce qu’il a fait, ce qu’il a traversé.
7. Contre les idoles morales et religieuses
Nietzsche attaque frontalement les figures religieuses, morales ou philosophiques qui prônent le renoncement, le sacrifice ou la culpabilité. Pour lui, ces valeurs sont des manifestations du nihilisme : elles nient la vie au nom d’un au-delà ou d’un idéal abstrait.
La vraie sagesse n’est pas dans l’ascèse ou la résignation, mais dans la joie tragique, l’acceptation du chaos, la capacité de créer du sens à partir de l’instant présent, sans recours à un dieu ni à une vérité éternelle.
8. Une morale de créateurs et non de disciples
Le philosophe, dans cette perspective, n’est pas un prêcheur de vérités immuables, mais un créateur de valeurs. Il ne transmet pas une doctrine figée, mais invente sa propre manière de vivre. Il faut, selon Nietzsche, devenir soi-même, se libérer des influences religieuses, morales, sociales, pour affirmer sa propre puissance.
C’est une éthique exigeante, tournée vers l’action et la responsabilité personnelle, à l’opposé des philosophies de la soumission ou du confort spirituel.
💡 Conclusion
Cet épisode offre une plongée dans le cœur battant de la pensée nietzschéenne : la réhabilitation du réel, de l’instant, de la volonté, contre toutes les formes de nihilisme moral et religieux. Aimer le vouloir qui nous veut, c’est se hisser à la hauteur de ce qui est, sans rien renier, en assumant pleinement sa vie comme un acte de création. Loin des espérances métaphysiques, Nietzsche appelle à une vie vécue en pleine conscience, dans la joie tragique de l’existence.
📚 Philosophes mentionnés
Platon (env. 428 – env. 348 av. J.-C.) — Philosophe grec, fondateur de l’idéalisme, opposé au monde sensible.
Saint Augustin (354 – 430) — Philosophe chrétien, développe une vision linéaire du temps et du salut.
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) — Philosophe allemand, auteur de Ainsi parlait Zarathoustra, théoricien de l’éternel retour et de l’amor fati.
Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie








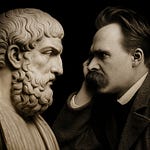


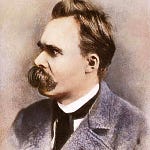


Share this post