1. Introduction
Michel Onfray poursuit sa réflexion sur Jean-Marie Guyau, cette fois à travers sa pensée esthétique. Il explore les liens entre art, morale, vitalisme et politique, en montrant comment l’idéal artistique de Guyau, fondé sur la vie, peut paradoxalement dériver vers des formes autoritaires.
2. Une esthétique vitaliste
Pour Guyau, l’art véritable est celui qui célèbre la vie et promeut la vitalité. L’œuvre d’art doit avoir un effet tonique, élever l’âme et le corps. Elle ne saurait être neutre ou décadente : elle doit être un moteur de puissance.
3. L’art au service de la morale
Guyau conçoit une esthétique qui prolonge son éthique : il s’agit d’éduquer à la volonté, non au savoir. L’art devient un outil de moralisation sociale, à travers une célébration du beau, du sain, du fort, contre le morbide et l’égotique.
4. Contre l’art décadent
Il fustige les artistes de son temps, qu’il accuse d’intellectualisme stérile, de complaisance dans la souffrance, et de perversion morale. Verlaine, Baudelaire, Zola sont accusés de produire un art maladif, nuisible à la société.
5. Une rhétorique du déclin
Guyau emploie un vocabulaire médical pour désigner l’art moderne : névrose, délinquance, détraquement. Il relie cette dégénérescence artistique à un affaiblissement moral et politique, voire à une menace civilisationnelle.
6. Un art pour éduquer
L’artiste doit avoir une mission : éduquer, régénérer, élever. L’art n’est pas une fin en soi mais un moyen au service d’un projet vitaliste, éducatif et national. Le culte de l’action, du risque, du sacrifice y est central.
7. Ambiguïtés politiques
Cette exaltation de la force et du commandement, cette hiérarchisation vitale des êtres, peuvent dériver vers des logiques autoritaires. Onfray montre que, sans le vouloir, Guyau fournit un soubassement idéologique à des régimes comme celui de Vichy.
8. Entre lumière et obscurité
Guyau reste un philosophe des Lumières : optimiste, rationaliste, éducationniste. Mais ce rationalisme débouche parfois sur une mystique sociale qui naturalise la hiérarchie et sacralise la vitalité, au détriment de la liberté.
💡 Conclusion
L’esthétique vitaliste de Guyau, bien qu’animée d’un idéal généreux, glisse vers une vision normative de l’art et de la société. L’art devient un moyen d’endoctrinement au service d’une morale de la puissance. Onfray met en garde contre cette dérive où l’expansion de la vie devient justification de la force, de l’inégalité, voire de la domination. L’histoire ultérieure, notamment celle des fascismes, résonne étrangement avec certaines thèses de Guyau.
📚 Philosophes mentionnés
Jean Meslier (1664 – 1729) — Prêtre athée français, emblème d’une critique radicale de la religion et figure citée en lien avec la pensée libre.
Voltaire (1694 – 1778) — Philosophe des Lumières, partisan d’un déisme rationaliste et d’un usage social de la religion.
Benjamin Franklin (1706 – 1790) — Philosophe, homme politique et imprimeur américain, cité par Guyau comme modèle d’éducation populaire, de morale pratique et de rationalisme.
Claude Adrien Helvétius (1715 – 1771) — Philosophe des Lumières, défenseur de l’idée que l’éducation peut tout transformer.
Paul-Henri Thiry d’Holbach (1723 – 1789) — Philosophe matérialiste et rationaliste, partisan d’une science contre les superstitions religieuses.
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) — Philosophe allemand du pessimisme, il inspire Guyau par son idée d’une théorie sans obligation de l’appliquer à la vie pratique.
Herbert Spencer (1820 – 1903) — Philosophe anglais et théoricien du darwinisme social, dont Guyau se démarque par une lecture plus solidaire et moins individualiste de l’évolution.
Charles Baudelaire (1821 – 1867) — Poète français accusé par Guyau d’esthétiser la souffrance, la décadence et l’égotisme.
Émile Zola (1840 – 1902) — Écrivain naturaliste français, taxé par Guyau de produire une littérature pathologique, reflet d’un affaiblissement social.
Paul Verlaine (1844 – 1896) — Poète symboliste, critiqué par Guyau pour sa complaisance dans les voluptés contre-nature.
Jean-Marie Guyau (1854 – 1888) — Philosophe français du vitalisme et de la morale sans obligation ni sanction, il développe une esthétique fondée sur la vie et l’élan, en opposition à la décadence de son époque.
Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie









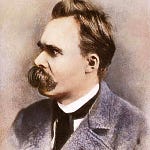




Share this post