1. Introduction : La figure du Grand Homme dans l’histoire
Cet épisode est centré sur la réflexion autour de la notion de « Grand Homme » dans l’histoire, à partir de la pensée de Jacob Burckhardt, historien suisse du XIXe siècle, et de l'influence de Goethe. Michel Onfray explore comment la conception d’un homme d’exception — figure à la fois créatrice, transgressive et tragique — façonne les grandes époques historiques, tout en interrogeant les tensions entre individualité et société.
2. Jacob Burckhardt, historien de la culture
Burckhardt (1818–1897) est présenté comme un historien à contre-courant, se méfiant du progrès, de la démocratie et de l’État. Il voit dans l’histoire un théâtre tragique dominé par des forces irrationnelles et cycliques, non par une marche linéaire vers le mieux. Il s’intéresse moins aux faits politiques qu’aux mouvements de civilisation, à travers l’art, la religion et la culture. Pour lui, l'histoire de la civilisation est rythmée par l'émergence de figures de rupture.
3. La Renaissance : berceau du Grand Homme
Burckhardt voit dans la Renaissance le moment par excellence où le Grand Homme s'affirme : figure libre, affranchie des contraintes religieuses et sociales, parfois criminelle, mais porteuse d’une puissance de création exceptionnelle. L’individualité triomphe contre les dogmes et les traditions, en générant des figures comme les condottieri, Machiavel, ou Léonard de Vinci. C’est une époque où les forces de l’histoire permettent à certains individus de concentrer en eux toute une époque.
4. La figure du Grand Homme selon Burckhardt
Selon Burckhardt, les « grands hommes » sont des êtres d’exception, à la fois créateurs et destructeurs, qui agissent en dehors des normes morales. Ils imposent leur volonté à l’histoire, devenant des catalyseurs de mutation. Onfray note que cette vision rejoint une lecture nietzschéenne de l’histoire : les grands hommes ne sont pas des modèles éthiques, mais des incarnations de la volonté de puissance. Ils échappent aux lois, aux dogmes, aux règles collectives. Ils ne sont pas admirés pour leur vertu, mais pour leur force.
5. La méfiance de Burckhardt envers la démocratie et la modernité
Burckhardt dénonce l’égalitarisme, la massification, la disparition des grandes individualités au profit de la médiocrité collective. Il critique l’État moderne, qu’il voit comme une machine anonyme écrasant la singularité. Il s’oppose à Hegel, à Marx, et à toute lecture finaliste ou dialectique de l’histoire. Il voit dans la modernité une ère de nivellement par le bas. L’histoire ne progresse pas, elle alterne des phases de grandeur et de décadence, suivant des cycles dominés par la force plutôt que par la raison.
6. Goethe et la vision aristocratique de l’individu
Goethe, que Burckhardt admire profondément, incarne selon lui le modèle du Grand Homme sans violence. Il est le poète, l’artiste, le savant, qui concentre en lui les puissances créatrices du monde. Goethe prône une vie intérieure intense, une distance aristocratique avec le tumulte du monde. Il cherche l'harmonie, la sagesse, la hauteur. Onfray y voit une tension entre deux types de grands hommes : le créateur calme et solaire (Goethe) et le héros tragique et violent (Napoléon).
7. Le tragique au cœur de l’histoire
Michel Onfray insiste sur la vision tragique de Burckhardt : l’histoire n’est pas rationnelle, ni orientée vers le bien. Elle est dominée par des forces chaotiques, la volonté de puissance, la lutte, le désordre. Le Grand Homme est celui qui assume cette tragédie, la traverse, et parfois en meurt. Onfray rapproche cette lecture de Nietzsche et de Spengler, en soulignant que Burckhardt annonce le déclin de la culture européenne, remplacée par une société sans âme dominée par l’économie.
8. Burckhardt contre l’histoire officielle
Enfin, Burckhardt est vu comme une figure de résistance intellectuelle face à l’histoire officielle, scolaire, moralisante. Il revendique une lecture aristocratique, élitiste, exigeante, de l’histoire. Il ne croit pas à l’éducation des masses, à la vertu du nombre ou aux vertus républicaines. Pour lui, seuls quelques individus exceptionnels changent le cours des choses.
💡 Conclusion
Michel Onfray nous offre ici une méditation sur le rôle de l’individu exceptionnel dans l’histoire. À travers Burckhardt et Goethe, il esquisse deux figures du Grand Homme : le créateur pacifique et le héros tragique. Tous deux incarnent une rupture avec la masse et la médiocrité, au prix d’un isolement radical. L’histoire, selon cette vision, est tragique, non morale, et traverse des phases de grandeur que seul un petit nombre d’hommes peut incarner. Une perspective profondément anti-démocratique, mais lucide et puissante, sur les forces qui traversent les civilisations.
📚 Philosophes mentionnés
Léonard de Vinci (1452–1519) — Peintre, ingénieur et inventeur italien.
Niccolò Machiavel (1469–1527) — Philosophe politique italien, auteur du Prince.
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) — Poète, dramaturge et penseur allemand, figure du classicisme de Weimar.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) — Philosophe allemand, figure de l’idéalisme allemand.
Karl Marx (1818–1883) — Philosophe, économiste et théoricien du communisme.
Jacob Burckhardt (1818–1897) — Historien suisse, auteur de La Civilisation de la Renaissance en Italie.
Friedrich Nietzsche (1844–1900) — Philosophe allemand, auteur de Ainsi parlait Zarathoustra.
Oswald Spengler (1880–1936) — Philosophe et historien allemand, auteur du Déclin de l’Occident.
Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie







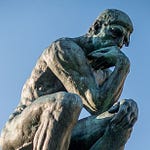





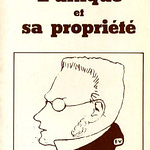
Share this post